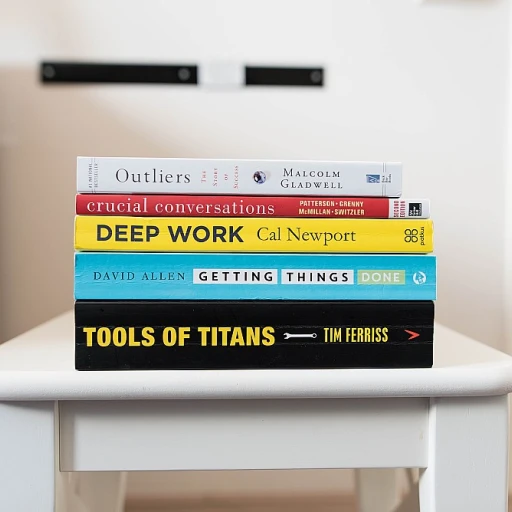-teaser.webp)
Anthony, pourriez-vous nous expliquer comment votre parcours en tant que formateur et consultant RSE a façonné votre vision de la responsabilité des consommateurs dans le contexte actuel ?
Avant 2018, la responsabilité sociétale des entreprises m’était totalement inconnue. C’est lors d’un séjour au Portugal, face à une plage recouverte de déchets plastiques, que s’est opérée une prise de conscience. Ce moment de désillusion a marqué un tournant profond dans ma trajectoire. En comprenant les impacts du changement climatique et de la pollution sur nos écosystèmes, j’ai entamé une transition écologique personnelle, avant de m’intéresser à la manière dont les entreprises pouvaient, elles aussi, contribuer à transformer le système.
C’est ainsi que j’ai découvert la RSE. Bien que pleinement engagé dans mon métier de consultant salarié, j’ai rapidement réalisé que ma place était ailleurs. J'ai alors fait le choix de me former et de devenir indépendant, ne trouvant aucun poste aligné avec ma vision : rendre la RSE accessible aux TPE et PME, en leur proposant une approche pédagogique, structurée, et adaptée à leur réalité. Comprendre les enjeux, réaliser un premier diagnostic, amorcer une dynamique d’amélioration continue : voilà ce qui m’anime.
Au départ, je pensais que l’engagement des entreprises permettrait de « sauver la planète ». Mais cette vision était erronée. Les transformations sont déjà à l’œuvre. Le contexte évolue vite, parfois trop vite. Aussi, aujourd’hui, ma mission n’est pas seulement d’outiller des structures, mais d’accompagner les personnes qui les composent. Car une entreprise, c’est avant tout un collectif humain. En s’appuyant sur la RSE, chaque individu peut mieux comprendre les enjeux sociaux, environnementaux et économiques de notre époque, et ainsi, se préparer aux mutations en cours.
Les dix prochaines années ne ressembleront pas aux dix précédentes. Cela ne signifie pas que l’avenir sera meilleur ou pire, simplement qu’il sera différent. Pour y faire face, il faudra développer plus de résilience, à la fois individuellement et collectivement. C’est là que réside, selon moi, la vraie responsabilité des consommateurs : devenir des actrices et acteurs lucides et engagés du changement, au quotidien individuellement et collectivement dans leur entreprise.
Vous enseignez la RSE dans des grandes écoles. Quelles sont les notions ou les compétences que vous jugez essentielles pour les futurs leaders en matière de responsabilité sociale des entreprises ?
La RSE reste encore trop souvent méconnue ou réduite à des actions environnementales ou philanthropiques. Pourtant, elle dépasse largement ces dimensions. Il s’agit d’un sujet transversal, qui irrigue l’ensemble des fonctions d’une organisation : relation client, conditions de travail, politique d’achats, gouvernance… Quelle que soit la voie professionnelle choisie, les enjeux de responsabilité sociétale feront partie intégrante du quotidien des futurs diplômé·es.
C’est pourquoi il est essentiel, dans l’enseignement supérieur, de transmettre une vision globale et systémique de la RSE. L’objectif n’est pas seulement de sensibiliser, mais de permettre à chaque étudiant·e de comprendre comment son futur métier pourra contribuer à une transition plus juste et durable. En prenant de la hauteur sur le fonctionnement des entreprises, en identifiant les leviers d’action à leur portée, les étudiant·es peuvent développer une posture critique et constructive. Cela les prépare à intégrer une démarche d’amélioration continue et à devenir des professionnel·les capables de conjuguer performance économique, impact social et respect des limites planétaires.
En tant que mentor pour des entrepreneurs en reconversion, quelles sont les questions ou préoccupations les plus fréquentes que ces entrepreneurs ont concernant l'intégration de la RSE ?
La question la plus fréquente reste la même : vais-je réussir à trouver un emploi ou, en tant qu’indépendant·e, à trouver des clients ? Et c’est une préoccupation légitime. Sur le marché de l’emploi, les postes explicitement liés à la RSE sont encore rares et souvent réservés à des profils très techniques, dans des structures déjà sensibilisées.
Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’opportunités. Bien au contraire. En 2024, une étude conjointe de Kerlotec, Goodwill-management et l’Agence LUCIE a évalué le niveau d’engagement RSE de 160 000 entreprises françaises de plus de 10 salarié·es. Résultat : seules 8 % d’entre elles présentent un engagement fort. Autrement dit, 92 % des entreprises sont encore peu, voire pas du tout engagées. Le vrai enjeu est là.
Pour les personnes en reconversion, cela signifie qu’il est possible d’apporter une plus-value réelle à ces structures, en s’appuyant d’abord sur ses compétences métier (ressources humaines, marketing, commercial, logistique, etc.), tout en y intégrant une sensibilité RSE. C’est une manière concrète d’agir de l’intérieur, et d’accompagner les entreprises dans leurs premiers pas vers la transition.
Pour les indépendant·es, le raisonnement est similaire. Plutôt que de viser uniquement les organisations déjà convaincues, il est plus pertinent et stratégique de se tourner vers celles qui n’ont pas encore enclenché de démarche. Selon cette même étude, près de 50 % des entreprises n’ont mis en place aucune action structurée en matière de RSE. C’est un vivier d’opportunités, souvent inexploité, pour celles et ceux qui souhaitent accompagner la transformation, avec pédagogie, patience et méthode.
Pouvez-vous partager un exemple d'atelier que vous animez et qui suscite généralement des prises de conscience ou des changements de comportement significatifs chez les participants ?
Au sein du collectif Oser la RSE, un atelier en particulier suscite régulièrement des déclics importants, notamment auprès de publics peu sensibilisés ou sceptiques quant à l’intérêt de la RSE.
L’atelier s’adresse aux collaborateur·rices qui ne perçoivent pas encore en quoi la RSE peut concerner leur quotidien. Plutôt que d’entrer frontalement dans les enjeux sociétaux ou environnementaux, la démarche commence par une mise en situation concrète : pour quelles raisons un client pourrait-il quitter l’entreprise ? Les réponses fusent rapidement : manque de transparence, mauvaise réputation, qualité de service en baisse, désengagement des équipes, etc.
À partir de là, les participant·es identifient collectivement des leviers d’action pour éviter ces situations. C’est à ce moment précis que l’éclairage est posé : toutes ces actions relèvent d’une démarche RSE. Cette prise de conscience crée un pont immédiat entre la réalité de terrain et les enjeux stratégiques plus larges.
Une fois ce lien établi, l’atelier permet d’introduire, de manière fluide, les grands enjeux environnementaux, sociaux et économiques que l’entreprise devra anticiper dans les années à venir. Les participant·es comprennent alors que la RSE n’est pas une contrainte extérieure, mais un outil de résilience, de cohérence et de performance durable. À la sortie, beaucoup expriment une nouvelle curiosité, et surtout, une volonté de s’impliquer concrètement.
En quoi la responsabilisation des consommateurs influence-t-elle les pratiques RSE des entreprises, et quels rôles les éducateurs comme vous jouent-ils dans cette dynamique ?
Dans notre modèle de société, la logique économique reste dominante. Le chiffre d’affaires, et donc les attentes des consommateurs, influence fortement les décisions des entreprises. C’est pourquoi, dans la majorité des cas, les structures qui sollicitent Oser la RSE ne le font pas d’abord par conviction environnementale ou sociale. Elles nous contactent parce qu’elles peinent à valoriser une démarche RSE lors d’appels d’offres, ou parce que leurs clients commencent à exiger plus de transparence et d’engagement.
Autrement dit, la pression vient du terrain, et notamment des consommateurs. Plus ces derniers exprimeront des attentes claires en matière de responsabilité sociétale, plus les entreprises devront y répondre, sous peine de perdre des parts de marché ou leur crédibilité. C’est là que le rôle des éducateurs et des accompagnant·es prend tout son sens : aider les structures à comprendre que la RSE n’est pas un effet de mode, mais une condition de pérennité.
En partant de leur besoin immédiat (sécuriser une relation client, gagner un marché) il devient possible d’ouvrir la réflexion sur ce que signifie réellement « s’engager ». Cela crée un espace pour parler des enjeux de fond : équité, climat, biodiversité, justice sociale… Et dans cet espace, des transformations plus profondes peuvent émerger.
Avec l'évolution rapide des attentes des consommateurs en matière de durabilité, pensez-vous que les entreprises s'adaptent suffisamment vite ? Quels sont les principaux défis que vous observez ?
Les entreprises ne s’adaptent pas assez vite. Elles restent, dans leur grande majorité, en décalage par rapport à l’évolution rapide des attentes sociétales, notamment en matière de durabilité. Ce retard s’explique souvent par une incompréhension persistante de ce qu’est réellement la RSE : non pas une contrainte ou un supplément d’âme, mais un levier stratégique au service de la pérennité du modèle économique.
Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises ne s’engagent dans une démarche RSE que lorsqu’elles rencontrent une difficulté : perte d’un client, difficulté à recruter, mauvaise image… La RSE devient alors un réflexe défensif, une réponse à une pression externe. Autrement dit, on est dans la réactivité plutôt que dans la proactivité.
Et c’est là tout le paradoxe : en anticipant ces enjeux, les structures pourraient avancer à leur rythme, sans être sous pression commerciale ou concurrentielle. Le principal défi reste donc la prise de conscience. Comprendre que la RSE n’est pas un luxe, mais une nécessité pour faire face aux transformations en cours, qu’elles soient environnementales, sociales ou économiques.
Si un consommateur souhaite devenir plus responsable mais ne sait pas par où commencer, quel conseil concret lui donneriez-vous pour intégrer la responsabilité dans sa vie quotidienne et ses choix d'achat ?
Pour une personne qui souhaite adopter une démarche plus responsable sans savoir par où commencer, un excellent point de départ est la lecture du livre Ça commence par moi de Julien Vidal. Cet ouvrage retrace une expérience simple et profondément humaine : celle d’adopter une action responsable par jour pendant un an.
Ce livre m’a profondément marqué, pour deux raisons essentielles. D’abord, parce qu’il montre que l’engagement est un chemin progressif. On ne transforme pas son mode de vie du jour au lendemain. Une transition durable passe par une approche bienveillante envers soi-même, en acceptant d’avancer pas à pas. Ensuite, parce qu’il met en lumière une vérité souvent oubliée : changer peut être une source d’épanouissement. Depuis 2018, je chemine moi aussi sur cette voie, et chaque nouvelle action responsable mise en place dans mon quotidien m’apporte du sens et de la satisfaction.
Le bonus ? Ça commence par moi propose 360 actions concrètes, applicables dans toutes les sphères de la vie. Chacun·e peut y piocher selon ses envies, ses capacités, et son contexte. Ce n’est pas une injonction à la perfection, mais une invitation à commencer, là où l’on est, avec ce que l’on peut.
Pour plus d'informations : https://www.oser-la-rse.fr